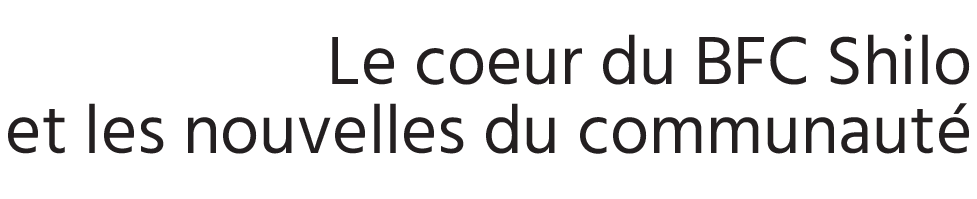Image d’une femme qui rêve. Thomas Goenczi est un ancien combattant de la RCN et un conseiller clinique diplômé qui exerce en cabinet privé : Well Then therapy, et contribue à une série d’articles sur le syndrome de stress post-traumatique et les rêves. (Photo : Pixabay)
Thomas Goenczi
Contributeur Shilo Stag
Le terme cauchemar vient du mot mare du XIVe siècle, qui désignait un esprit ou une entité féminine maléfique qui tourmentait les gens (ou les chevaux) dans leur sommeil.
Les détails de ce mythe varient d’une culture à l’autre. L’essentiel de l’histoire est qu’une jument attend que vous posiez votre tête pour vous reposer le soir. Pendant que vous vous endormez dans le monde des rêves, l’entité se glisse par le trou de la serrure de votre chambre, se glisse sur votre lit, s’assoit sur votre poitrine et vous étouffe de son poids.
Vous étiez alors paralysé et incapable de vous réveiller.
Il est à noter que le terme « cauchemar » a d’abord été explicitement inventé pour désigner la paralysie du sommeil, mais dans les années 1800, il est devenu un terme générique pour désigner n’importe quel mauvais rêve.
Chaque culture traite ses cauchemars différemment.
Dans la culture polonaise, les gens prennent des mesures de protection telles qu’inviter la jument pour le petit-déjeuner, laisser une botte de foin dans leur lit et dormir dans une autre pièce pour empêcher la jument de drainer leur énergie.
Dans le folklore japonais, on invoque la créature mythologique Baku en l’invoquant trois fois pour qu’elle dévore les mauvais rêves.
En Afrique, on fait appel à des chamans ou à des guérisseurs spirituels pour interpréter les rêves et aider à purifier l’individu de tout esprit malveillant.
La façon dont nous traitons les cauchemars a évolué depuis l’avènement de la psychologie. Freud et Jung – les pères de la psychologie – pensaient que les cauchemars étaient la répétition d’un dilemme stressant.
Ce courant de pensée est devenu la base des rêves de type SSPT. Lorsque nous pensons à un rêve basé sur un traumatisme, nous comprenons généralement qu’il s’agit d’une partie de nous-mêmes qui n’a pas encore été entièrement traitée.
Lorsque ce thème continue de surgir dans notre psyché, nous disposons d’un minuscule répit pour permettre à notre corps et à notre esprit de se rétablir complètement.Le traumatisme est incessant et continue à nous étouffer avec ses images et les émotions qui en découlent.avec ses images et les émotions qui l’accompagnent.
L’une des tâches les plus difficiles auxquelles nous sommes confrontés lorsque nous faisons face à notre traumatisme est de le comprendre afin de pouvoir enfin l’affronter.Lorsque nous parvenons à le comprendre, nous savons à quoi nous nous heurtons.
D’une certaine manière, l’entité à laquelle nous sommes confrontés n’est plus mystérieuse, ce qui nous permet d’aborder notre traumatisme avec plus de recul.Nous devons démystifier le traumatisme, car c’est là qu’il démontre son pouvoir – dans l’inconnu.
Les cauchemars basés sur un traumatisme peuvent être horribles.Qu’ils soient rares ou fréquents, il n’est jamais facile de supporter les effets mentaux, émotionnels et physiques qu’ils peuvent avoir sur nous.Cependant, ces rêves peuvent également nous permettre de faire le point sur l’évolution de notre traumatisme.
Souvent, les personnes souffrant de SSPT remarqueront que leurs rêves évoluent au fur et à mesure qu’elles progressent dans la gestion de leur traumatisme.Des images spécifiques le feront intuitivement savoir.
Les cauchemars sont choquants et déstabilisants.Cependant, ce n’est pas pour cette raison que nous devons les éviter ; au contraire, nous pouvons les considérer comme une invitation à une exploration plus profonde de nous-mêmes.
Se connaître soi-même est l’une des plus grandes responsabilités de notre vie.Notre psyché nous offre certaines opportunités pour cette exploration, et les cauchemars n’en sont qu’une parmi d’autres.
Thomas Goenczi est un ancien combattant de la MRC et un conseiller clinique diplômé qui exerce en cabinet privé :Well Then Therapy.
Le contenu de ce site n’est pas destiné à remplacer les conseils, le diagnostic ou le traitement d’un professionnel. Demandez toujours l’avis de votre professionnel de la santé mentale ou d’un autre prestataire de soins qualifié pour toute question relative à votre état de santé